|
Les sciences en voie de formation ont le privilège, médiocrement
enviable, de servir comme d'un asile provisoire à tous
les problèmes qui flottent dans l'air, sans avoir encore trouvé leur
véritable place.
Par l'indétermination et l'accès facile de
leurs frontières, elles attirent
tous les »sans patrie« de la science, jusqu'à ce qu'elles
aient pris assez de force pour rejeter hors
d'elles tous ces éléments
étrangers; l'opération est parfois cruelle, mais elle épargne bien
des déceptions pour l'avenir.
C'est
ainsi que la sociologie, cette science nouvelle, commence à se
débarrasser de la masse confuse de problèmes qui s'attachaient
à elle; elle prend le parti de
ne plus naturaliser le premier venu, et, quoiqu'on discute
encore sur l'étendue de son domaine, d'évidents efforts sont faits
pour en marquer les contours.
Pendant longtemps, il semblait que le mot sociologie eût une
vertu magique; c'était la clef de toutes les énigmes de l'histoire
comme de la pratique, de la morale comme de l'esthétique, etc.
C'est qu'on donnait pour objet à la sociologie tout ce qui se
passe dans la société; par suite,
tous les faits qui ne sont pas de
l'ordre physique semblaient être
de son ressort.
Mais cela
même démontre l'erreur qu'on commettait en procédant ainsi.
Car c'est évidemment un non-sens que de réunir tous les sujets
d'étude dont traitent déjà l'économie politique et l'histoire de
la civilisation, la philosophie et la politique, la statistique et
la
démographie, dans une sorte de pêle-mêle auquel on accole
cette étiquette de sociologie.
On y gagne un nom nouveau, mais
pas une connaissance nouvelle.
Sans doute, il n'y a pas de
recherche sociologique qui n'intéresse quelqu'une des sciences déjà
existantes; car, dans ce qui fait la matière de la vie
humaine,
il n'est rien qui ne soit déjà l'objet de quelqu'une de ces
sciences.
Mais c'est justement la preuve que, pour avoir un
sens défini, la sociologie doit chercher ses problèmes, non dans
la matière de la vie sociale, mais dans sa forme; et c'est cette
forme qui donne leur caractère
social à tous ces faits dont
s'occupent les sciences
particulières.
C'est sur cette considération
abstraite des formes sociales que repose tout le droit que la
sociologie a d'exister; c'est ainsi que la géométrie doit son
existence à la possibilité d'abstraire, des choses matérielles,
leurs formes spatiales, et la linguistique la sienne, à la
possibilité
d'isoler, des pensées qu'expriment les hommes, la forme même
de l'expression.
Les formes qu'affectent les groupes d'hommes unis pour
vivre les uns à côté des autres,
ou les uns pour les autres, ou les
uns avec les autres, voilà donc
le domaine de la sociologie.
Quant aux fins économiques, religieuses, politiques, etc., en vue
desquelles ces associations prennent naissance, c'est à
d'autres sciences qu'il appartient d'en parler.
Mais alors, puisque toute
association humaine se fait en vue de telles fins,
comment connaîtrons-nous les
formes et les lois propres de
l'association? En rapprochant les
associations destinées aux
buts les plus différents et en dégageant ce qu'elles ont de
commun.
De cette façon, toutes les différences que présentent
les fins spéciales autour desquelles les sociétés se constituent, se
neutraliseront mutuellement, et la forme sociale sera seule à
ressortir.
C'est ainsi qu'un phénomène comme la formation des
partis se remarque aussi bien dans le monde artistique que dans
les milieux politiques, dans l'industrie que dans la religion.
Si donc on recherche ce qui se
retrouve dans tous ces cas en dépit
de la diversité des fins et des
intérêts, on obtiendra les espèces et
les lois de ce mode particulier
de groupement.
La même méthode nous permettrait d'étudier de la même manière la domination
et la subordination, la formation des hiérarchies, la
division du travail, la concurrence, etc.
Quand ces nombreuses
formes de l'association humaine auront été établies
inductive-
ment et qu'on aura trouvé leur signification psychologique,
alors seulement on pourra penser à résoudre la question: Qu'est-
ce qu'une société? Car il est bien sûr que la société n'est pas un
être simple, dont la nature puisse être exprimée tout entière
dans une seule formule.
Pour en avoir la définition, il faut
sommer toutes ces formes spéciales de l'association et toutes
les forces qui en tiennent unis
les éléments.
Il ne peut pas y
avoir de société où ces combinaisons variées ne se rencontrent.
Sans doute, chacune d'elles, prise à part, peut disparaître sans
que le groupe total disparaisse; mais c'est que, chez tous les
peuples connus, il en subsiste toujours un nombre suffisant.
Que si on les supprime toutes par la pensée, il n'y a plus de
société du tout1.
1
Cf. sur cette manière de poser le problème sociologique, mon article
sur »Le problème de la sociologie« in Revue de Métaph. t. II,
p. 497
[in GSG 19, S. 27-35]. On trouvera quelques applications de ce
principe dans ma Sociale Differenzierung, Leipzig, 1890 [in
GSG
2, S. 109-295]. V. également Annales de l'Institut de sociologie,
vol I [in GSG 19, S. 36-45], et American Journal of
Sociology, vol. II nos 2
et 3 [in GSG 18].
Afin d'illustrer par un exemple la méthode ainsi définie, je
voudrais, dans cet article, rechercher les formes spécifiques par
lesquelles les sociétés, en tant que telles, se conservent.
Par
société, je n'entends pas
seulement l'ensemble complexe des
individus et des groupes unis dans une même communauté
politique.
Je vois une société partout où des hommes se trouvent
en réciprocité d'action et constituent une unité permanente
ou passagère.
Or, dans chacune de ces unions se produit
un phénomène qui caractérise également la vie individuelle; à
chaque
instant, des forces perturbatrices, externes ou non,
s'attaquent au groupement, et,
s'il était livré à leur seule action, elles ne tarderaient
pas à le dissoudre, c'est-à-dire à en transférer
les éléments dans des groupements étrangers.
Mais à ces
causes de destruction s'opposent des forces conservatrices qui
maintiennent ensemble ces éléments, assurent leur cohésion, et
par là garantissent l'unité du tout jusqu'au moment où, comme toutes
les choses terrestres, ils s'abandonnent aux puissances
dissolvantes
qui les assiègent.
A cette occasion, on peut voir combien il est juste de présenter
la société comme une unité sui generis, distincte de ses
éléments individuels.
Car les énergies qu'elle met en jeu pour se
conserver n'ont rien de commun avec l'instinct de conservation
des individus.
Elle emploie pour cela des procédés tellement
différents que très souvent la vie des individus reste intacte et
prospère alors que celle du groupe s'affaiblit, et inversement.
Plus que tous les autres, ces faits ont contribué à faire tenir la
société pour un être d'une réalité autonome, qui mènerait,
suivant des lois propres, une vie indépendante de celle de ses
membres.
Et en réalité, si l'on considère la nature intrinsèque et
l'évolution des langues et des mœurs, de l'Église et du droit, de
l'organisation politique et sociale, cette conception s'impose.
Car tous ces phénomènes apparaissent comme les produits et
les fonctions d'un être impersonnel auquel les individus participent
sans doute, comme à un bien public, mais sans qu'on
puisse désigner nommément un particulier qui en soit la cause
productrice ou la raison déterminante; pas un même dont on
puisse dire quelle part précise il a prise à leur production.
Elles
se posent en face des particuliers comme quelque chose qui les
domine et qui ne dépend pas des mêmes conditions que la vie
individuelle.
D'un autre côté, il est certain qu'il n'existe que des individus,
que les produits humains n'ont de réalité en dehors des hommes
que s'ils sont de nature matérielle, et que les créations dont
nous parlons, étant spirituelles, ne vivent que dans des intelligences
personnelles.
Comment donc, si les êtres individuels
existent seuls, expliquer le caractère supra-individuel des phénomènes
collectifs, l'objectivité et l'autonomie des formes
sociales? Il n'y a qu'une
manière de résoudre cette antinomie.
Pour une connaissance parfaite, il faut admettre qu'il n'existe rien
que des individus.
Pour un regard qui pénétrerait le fond
des choses, tout phénomène qui paraît constituer au-dessus des
individus quelque unité nouvelle et indépendante, se résoudrait
dans les actions réciproques échangées par les individus.
Malheureusement,
cette connaissance parfaite nous est interdite.
Les rapports qui s'établissent entre les hommes sont si complexes
qu'il est chimérique de les vouloir ramener à leurs éléments
ultimes.
Nous devons plutôt les traiter comme des
réalités qui se suffisent à elles-mêmes.
C'est donc seulement
par un procédé de méthode que nous parlons de l'État, du droit,
de la mode, etc., comme si c'étaient des êtres indivis.
C'est ainsi
encore que nous parlons de la vie comme d'une chose unique,
tout en admettant qu'elle se réduit à un complexus d'actions et
de réactions physico-chimiques échangées entre les derniers éléments
de l'organisme.
Ainsi se résout le conflit soulevé entre
la conception individualiste et ce qu'on pourrait appeler la
conception moniste de la société; celle-là correspond à la réalité,
celle-ci à l'état borné de nos facultés d'analyse; l'une est l'idéal
de la connaissance, l'autre exprime sa situation actuelle.
Cela posé, de même que le biologiste a déjà pu substituer à la
force vitale, qui paraissait planer au-dessus des différents
organes, l'action réciproque de ces derniers, le sociologue, à son
tour, doit chercher de plus en plus à atteindre ces processus
particuliers qui produisent réellement les choses sociales, à
quelque distance d'ailleurs
qu'il doive rester de son idéal.
Voici
donc, pour ce qui concerne l'objet spécial de cet article, comment
le problème doit se formuler.
Nous croyons voir que les
associations les plus différentes mettent en jeu, pour persévérer
dans leur être, des forces spécifiques; en quels processus plus
simples ce phénomène peut-il se résoudre? Bien que le groupe,
une fois qu'il existe, paraisse faire preuve, dans ses efforts pour
se maintenir, d'une énergie vitale et d'une force de résistance qui
semblent provenir d'une source unique, elle n'est cependant
que la conséquence, ou mieux la résultante de phénomènes,
particuliers et variés, de nature sociale.
Ce sont ces phénomènes
qu'il faut rechercher.
I
Ce qui pose le plus ordinairement le problème de la permanence
propre aux groupes sociaux, c'est ce fait qu'ils se maintiennent
identiques à eux-mêmes, tandis que leurs membres changent ou
disparaissent.
Nous disons que c'est le même État,
la même armée,
la même association qui existe aujourd'hui et
qui existait déjà il y a des
dizaines et peut-être des centaines
d'années; cependant, parmi les
membres actuels du groupe, il
n'en est pas un qui soit le même
qu'autrefois.
Nous avons affaire ici à l'un de ces cas où la disposition des
choses dans
le temps présente une remarquable analogie avec leur disposition
dans l'espace.
Le fait que les individus sont à côté les uns
des autres, par conséquent extérieurs les uns aux autres, n'empêche
pas l'unité sociale de se constituer; l'union spirituelle des
hommes triomphe de leur séparation spatiale.
De même, la séparation temporelle des générations n'empêche pas que
leur
suite ne forme, pour notre représentation, un tout ininterrompu.
Chez les êtres que l'espace sépare, l'unité résulte des
actions et des
réactions qu'ils échangent entre eux; car l'unité
d'un tout complexe ne signifie
rien autre chose que la cohésion
des éléments, et cette cohésion
ne peut être obtenue que par le
concours mutuel des forces en présence.
Mais pour un tout
composé
d'éléments qui sont séparés par le temps, l'unité ne peut être
réalisée de cette manière, parce qu'il n'y a pas entre eux de
réciprocité d'action; les plus anciens peuvent bien agir
sur ceux qui viennent ensuite,
mais non ceux-ci sur ceux-là.
C'est pourquoi la survivance de l'unité sociale au milieu du flux
perpétuel des individus reste un problème à résoudre, alors même que
la genèse de cette unité a déjà été expliquée.
Le facteur dont l'idée se présente le plus immédiatement à l'esprit
pour rendre compte de la continuité des êtres collectifs,
c'est la permanence du sol sur lequel ils vivent.
L'unité, non pas
seulement de l'État, mais de la ville et de bien d'autres associations,
tient d'abord au territoire qui sert de substrat durable à
tous les changements que subit l'effectif de la société.
A vrai dire, la permanence du lieu
ne produit pas à elle seule la permanence de l'unité sociale;
car, quand la population est
expulsée ou asservie par un peuple conquérant, nous disons
que l'État a changé, bien que le territoire reste le même.
En outre, l'unité dont il s'agit
ici est toute psychique, et c'est cette unité psychique qui fait
vraiment l'unité territoriale, loin d'en dériver.
Cependant, une fois que celle-ci s'est constituée, elle
devient à son tour un soutien pour la première et l'aide à se
maintenir.
Mais bien d'autres conditions sont nécessaires.
La
preuve, c'est que nombre de groupes n'ont aucun besoin de
cette base matérielle.
Ce sont d'abord les petites sociétés
comme la famille qui peuvent rester sensiblement identiques
à elles-mêmes, tout en changeant de résidence; mais ce sont
aussi les très grandes, comme
les associations internationales de
lettrés, d'artistes et de
savants, ou comme ces sociétés commerciales
qui s'étendent à tout l'univers, et qui consistent
essentiellement dans une négation
de tout ce qui attache la vie sociale à des localités
déterminées.
En définitive, cette première condition n'assure guère que
d'une manière formelle la persistance du groupe à travers le
temps.
Un facteur incomparablement plus efficace, c'est la
liaison
physiologique des générations, c'est la chaîne formée
entre les individus par les
relations de parenté en général.
Sans
doute, la communauté du sang ne suffit pas toujours à garantir
bien longtemps l'unité de la vie collective; il faut très souvent
qu'elle soit complétée par la communauté de territoire.
L'unité
sociale des Juifs, malgré leur unité physiologique et confessionnelle,
s'est singulièrement détendue depuis leur dispersion;
elle ne s'est
plus jamais solidement renouée que là où un de leurs groupes est
resté fixé pendant assez longtemps sur un même territoire.
Mais, d'un
autre côté, partout où les autres
liens font défaut, le lien
physiologique est l'ultimum refugium
de la continuité sociale.
Ainsi, quand la corporation allemande
(Zunft)
dégénéra et s'affaiblit intérieurement, elle se ferma
d'autant plus
étroitement au dehors que sa force de cohésion
se relâchait davantage; de là
vint la règle que les fils de maître,
les gendres de maître, les maris
de veuve de maître pourraient seuls être admis à la maîtrise.
Ce qui fait l'efficacité de ce facteur, c'est que les générations
ne se remplacent pas d'un seul coup.
De cette façon, l'immense
majorité des individus qui vivent ensemble à un moment donné
existent encore au moment qui suit, et le passage de l'un à
l'autre est
continu.
Les personnes
qui changent entre deux instants voisins, soit qu'elles sortent de
la société, soit qu'elles y
entrent, sont toujours en très petit nombre, comparées à
celles qui demeurent.
Le fait que l'homme n'est pas, comme
les animaux, assujetti à une saison d'accouplement, et que par suite
ses enfants peuvent naître en tout temps, est ici d'une
particulière
importance.
Il en résulte
en effet qu'on ne peut jamais
fixer un moment déterminé où une génération nouvelle
commence.
La sortie des éléments anciens et l'entrée des nouveaux
s'opèrent si progressivement que le groupe fait l'effet
d'un être unique, tout comme un
organisme au milieu de
l'écoulement incessant de ses atomes.
Si cette substitution
s'effectuait d'un seul coup, si à une sortie en masse succédait
brusquement une entrée en masse, alors on ne serait guère
fondé à dire que le groupe, malgré la mobilité de ses membres,
subsiste dans son unité.
Mais que, à chaque moment, les nouveaux
venus soient une infime minorité par rapport à ceux qui
composaient
déjà la société au moment antérieur, voilà ce qui
lui permet de rester identique à
elle-même, quand même, à deux
époques plus éloignées, le
personnel social serait entièrement renouvelé.
Si cette continuité est surtout frappante là où elle a pour base
la génération, elle ne laisse pas d'exercer une action très sensible
dans certains cas où pourtant cet intermédiaire physique manque
totalement.
C'est ce qui arrive pour le clergé catholique.
La
continuité y résulte de ce fait qu'il reste toujours assez de
membres anciens en fonction pour initier les nouveaux.
L'importance
de ce phénomène sociologique est considérable, car
c'est ce qui rend si stables, par exemple, les corps de
fonctionnaires; c'est ce qui leur permet de maintenir invariable, à
travers tous les changements individuels, l'esprit objectif qui fait
leur essence.
Dans tous ces cas, le fondement physiologique de la
continuité sociale est remplacé par un fondement psychologique.
Sans doute, à parler à la rigueur, cette continuité n'existe
qu'autant que les individus ne changent point.
Mais, en fait, les
membres qui composent le groupe à un moment donné y restent toujours
un temps suffisant pour pouvoir façonner
leurs successeurs à leur image, c'est-à-dire selon l'esprit et
les tendances de la société.
C'est ce renouvellement lent et progressif du groupe qui en
fait l'immortalité, et cette immortalité est un phénomène sociologique
d'une très haute portée.
La conservation de l'unité
collective pendant un temps théoriquement infini donne à
l'être social une valeur qui, ceteris paribus, est infiniment
supérieure
à celle de chaque individu.
La vie individuelle est tout
entière organisée pour finir dans un temps donné, et, dans une
certaine mesure, chaque individu commence lui-même, à nouveaux
frais, sa propre existence.
La société, au contraire, n'est
pas enfermée a priori dans une durée limitée; elle semble instituée
pour l'éternité, et c'est pourquoi elle arrive à totaliser
des conquêtes, des forces, des
expériences qui l'élèvent bien au-
dessus des existences
particulières et de leurs perpétuels recommencements.
C'est là ce qui fit la force des corporations
urbaines de l'Angleterre, depuis
le moyen âge.
Dès cette époque, dit Stubbs, elles avaient le droit »de perpétuer
leur existence
en comblant, au fur et à mesure, les vacances qui se
produisaient dans leur sein«.
Sans doute, les anciens privilèges
ne visaient que les bourgeois et leurs héritiers.
Mais, en fait, ce principe fut appliqué comme conférant le droit
d'adopter des membres nouveaux.
C'est pourquoi, quel que fût le sort de ses
membres et de leurs descendants proprement dits, la corporation,
en tant que telle, se conservait toujours in integro.
Toutefois ce résultat n'est obtenu que par l'effacement de
l'individu; son rôle personnel est en effet rejeté au second plan
par les fonctions qu'il remplit comme représentant et continuateur
du groupe.
Car la société court d'autant plus de risques
qu'elle dépend davantage de l'éphémère individualité de ses
membres.
Inversement, plus l'individu est un être impersonnel
et anonyme, plus aussi il est apte à prendre tout uniment la
place d'un autre et à assurer
ainsi la conservation ininterrompue
de la personnalité collective.
C'est ce précieux privilège
qui, dans la guerre des deux Roses, permit aux Communes d'abaisser
la suprématie de la Chambre haute.
En effet, une
bataille qui supprimait la moitié de la noblesse du pays enlevait
aussi à la Chambre des lords la moitié de sa puissance, parce que
celle-ci était liée au sort d'un certain nombre de personnalités
particulières.
Au contraire, les Communes étaient soustraites à
cette cause d'affaiblissement; comme elles jouissaient d'une sorte
d'immortalité grâce au nivellement de leurs membres, elles devaient
finir par s'emparer du pouvoir.
Cette même circonstance donne aux groupes un avantage dans les
luttes qu'ils soutiennent avec
les particuliers.
On a pu dire de la
Compagnie des Indes que, pour fonder sa domination sur les
indigènes, elle n'avait pas employé d'autres moyens que le
Grand Mogol.
Seulement elle eut cette supériorité sur les autres
conquérants de l'Inde qu'elle ne pouvait jamais être assassinée.
II
Ce qui précède explique pourquoi, dans les cas contraires,
c'est-à-dire quand la vie sociale se trouve être intimement liée à
celle d'un individu, directeur et dominateur du groupe, des
institutions très spéciales sont indispensables pour qu'il puisse
se maintenir.
Quels dangers cette forme sociologique peut faire
courir à la conservation des sociétés, l'histoire de tous les
interrègnes est là pour nous l'apprendre.
Mais ces périls sont
naturellement d'autant plus grands que le souverain concentre
plus complètement entre ses mains les fonctions par lesquelles
se recrée à chaque instant l'unité collective.
C'est pourquoi il peut être
assez indifférent que l'exercice du pouvoir soit un
instant suspendu là où la
domination du prince n'est que
nominale, où il règne, mais ne
gouverne pas; au contraire, un
État d'abeilles tombe dans une
anarchie complète dès qu'on l'a
privé de sa reine.
Sans doute, on ne doit pas se représenter cette
royauté sous la forme d'un gouvernement humain, puisqu'il
n'en émane pas d'ordres, à
proprement parler.
Cependant, c'est
la reine qui est le centre de l'activité de la ruche; car, se tenant
par ses antennes en communication perpétuelle avec les travailleuses,
elle est au courant de tout ce qui se passe dans son
royaume, et c'est ce qui permet à la société de prendre conscience
de son unité.
Mais aussi ce sentiment s'évanouit dès que
cet organe central, grâce auquel il s'élabore, a disparu.
L'inconvénient de cette concentration n'est pas seulement de
subordonner la conservation du groupe à l'existence contingente
d'un individu; le caractère personnel que prend alors le
pouvoir peut, par lui-même, devenir un danger.
Par exemple, si
la société mérovingienne maintint intactes, à bien des égards,
les vieilles institutions
romaines, cependant, sur un point essentiel, elle innova: la puissance publique devint chose personnelle,
transmissible et partageable.
Or ce principe, sur lequel se
fondait le pouvoir du roi, se tourna contre lui; car les grands,
qui contribuaient à la
constitution de l'empire, réclamèrent eux aussi une part
personnelle de domination.
Les sociétés politiques ont essayé de conjurer ces différents
dangers, surtout ceux qui résultent des interrègnes, en proclamant
le principe que le roi ne meurt pas.
Tandis qu'aux premiers temps du
moyen âge la paix du roi mourait avec le roi,
grâce à ce principe nouveau, la tendance du groupe à persévérer dans son
être prit corps.
En effet, une idée, très importante au
point de vue sociologique, y est impliquée, c'est que le roi n'est
pas roi en tant qu'individu.
Au contraire, sa personnalité est par
elle-même indifférente.
Elle n'a plus de valeur que comme
incarnatation de la royauté
abstraite, impérissable comme le
groupe même dont elle est la tête. Celui-ci projette son immortalité
sur le prince, qui en revanche la renforce par cela même
qu'il la symbolise.
Le procédé le plus simple pour exprimer la permanence du
groupe par celle du pouvoir, c'est la transmission héréditaire de
la dignité suprême.
La continuité physiologique de la famille
souveraine réfléchit alors celle de la société.
Celle-ci trouve son
expression, aussi adéquate que possible, dans cette loi qui fait
succéder au père le fils désigné depuis longtemps pour le trône
et toujours prêt à l'occuper.
En tant qu'il se transmet héréditairement,
le gouvernement est indépendant des qualités personnelles
du prince; or, c'est le signe que la cohésion sociale est
devenue une
réalité objective, pourvue d'une consistance et
d'une durée propres, et qui
n'est plus subordonnée à tous les
hasards des existences
individuelles.
Ce qu'on a justement
trouvé d'absurde et de nuisible dans le principe de l'hérédité,
à savoir ce formalisme qui permet d'appeler au pouvoir aussi
bien le moins capable que le plus méritant, cela même a un sens
profond: car c'est la preuve que la forme du groupement, que le
rapport entre gouvernants et gouvernés s'est fixé et objectivé.
Tant que la constitution du groupe est incertaine et vacillante,
les fonctions directrices exigent des qualités personnelles très
déterminées.
Ainsi, le roi
grec des temps héroïques ne devait
pas seulement être brave, sage et
éloquent; il fallait encore qu'il
fût un athlète distingué et même,
dans la mesure du possible,
excellent laboureur, charpentier et constructeur de vaisseaux.
D'une manière générale, là où l'association est encore instable,
elle veille, comme c'est son intérêt, à ce que le pouvoir ne soit
donné
qu'après une lutte et une concurrence entre les individus.
Mais là où la forme de l'organisation sociale est déjà solide
et définitive, alors les considérations personnelles deviennent
secondaires.
C'est le maintien de cette forme abstraite qui
importe, et le meilleur gouvernement est celui qui exprime le
mieux la continuité et l'éternité du groupe ainsi constitué.
Or
c'est le gouvernement héréditaire, car il n'en est pas qui réalise
plus
complètement le principe d'après lequel le roi ne meurt pas.
III
Un autre moyen pour l'unité sociale de s'objectiver est de
s'incorporer dans des objets impersonnels qui la symbolisent.
Le rôle de ces symboles est surtout considérable quand, outre
leur sens
figuré, ils possèdent encore une valeur intrinsèque,
qui leur permet de servir, en
quelque sorte, de centre de ralliement
aux intérêts matériels des individus.
Dans ce cas, il importe tout particulièrement à la conservation du
groupe de
soustraire ce bien commun à toute cause de destruction, à
peu près comme on soustrait le pouvoir personnel aux accidents
de personnes en proclamant l'immortalité du prince.
Le
moyen le plus fréquemment employé dans ce but, c'est la
mainmorte, ce système d'après lequel les biens de l'association,
qui, en tant que tels, doivent être éternels, sont déclarés inaliénables.
De même que la nature éphémère de l'individu se reflète
dans le
caractère périssable de sa fortune, à la pérennité du
groupe correspond
l'inaliénabilité du patrimoine collectif.
En
particulier, le domaine des corporations ecclésiastiques ressembla
longtemps à la caverne du lion où tout peut entrer, mais
d'où rien ne sort.
L'éternité de leurs biens symbolisait l'éternité
du principe qui faisait leur unité.
Ajoutez à cela que les biens de
mainmorte consistaient essentiellement en biens fonciers.
Or,
contrairement aux meubles et, en particulier, à l'argent, les biens
en terre jouissent d'une stabilité, d'une perpétuité qui
en faisait la matière désignée de la mainmorte.
En même temps,
grâce à leur situation déterminée dans l'espace, ils servaient
comme de point fixe autour duquel gravitaient tous leurs
copropriétaires, tant par dévouement à la chose commune
que par souci de leurs intérêts bien entendus.
C'est ainsi que
la mainmorte
n'était pas seulement une source d'avantages
matériels; c'était encore un
procédé génial pour consolider l'unité collective et en
assurer la conservation.
Cette objectivité que la mainmorte et le fidéicommis donnent
aux biens collectifs en les soustrayant à l'arbitraire des
individus, les associations
modernes essaient de la réaliser par
d'autres moyens, mais qui
tendent au même but.
Ainsi, nombre
d'entre elles lient leurs membres en établissant que, s'ils se
retirent de l'association, ils ne pourront recouvrer ce qu'ils
auraient versé à la caisse
commune.
C'est la preuve que la
sphère des intérêts sociaux s'est constituée en dehors de celle
où se meuvent les individus, que
le groupe vit d'une vie propre,
qu'il s'approprie définitivement
les éléments qu'il a une fois
reçus et rompt tous les liens par
lesquels ils se rattachaient à des
propriétaires individuels.
Désormais, il ne peut pas plus les
rendre à ces derniers qu'un organisme ne peut restituer les
aliments, qu'il s'est une fois
assimilés, aux êtres qui les lui
ont fournis.
Ce modus procedendi ne favorise pas seulement
par ses résultats directs l'autoconservation de la société, mais il
y aide aussi et surtout en faisant vivre dans l'esprit de chacun de
ses membres l'idée d'une unité sociale, supérieure aux particuliers
et indépendante des caprices individuels.
Cette même technique sociologique se retrouve, mais encore
renforcée, dans une autre règle adoptée par certaines associations:
en cas de dissolution, elles s'interdisent de partager la
fortune commune entre leurs
membres, mais la lèguent à quelque société qui poursuit un but
analogue.
De cette manière, ce
n'est plus seulement l'existence physique du groupe qui se
maintient, c'est son idée, qui se réincarne dans le groupe héritier
et dont la continuité est garantie et, pour ainsi dire, manifestée par cette transmission des biens.
C'est particulièrement
sensible dans un assez grand nombre d'associations de travailleurs
qui se formèrent en France lors de la révolution de 1848.
Dans leurs statuts, le principe en vertu duquel le partage est
défendu reçut une extension nouvelle.
Les associations d'un même métier formaient entre elles un syndicat auquel chacune
léguait éventuellement ce fonds
qu'elles ne pouvaient pas partager.
Ainsi se constituait un nouveau fonds social où les
contributions des sociétés particulières venaient se fondre en
une unité objective d'un genre
nouveau, comme les contributions
des individus étaient venues se perdre dans le fonds
particulier de chaque
association.
Par là, l'idée qui était l'âme
de ces groupes élémentaires se trouvait comme sublimée.
Le
syndicat donnait un corps et une substance à ces intérêts
sociaux qui, jusque-là, n'avaient eu de réalité que dans ces
associations plus restreintes; le principe sur lequel elles
reposaient était élevé à une hauteur où, si des forces
perturbatrices
ne s'étaient rencontrées, il se serait maintenu invariable, au-
dessus de toutes les fluctuations qui pouvaient survenir dans les
personnes comme dans les choses.
IV
Nous avons considéré les cas où les formes sociales, pour se
maintenir, se solidarisent soit avec une personne, soit avec une
chose.
Voyons maintenant ce qui arrive quand elles s'appuient
sur un organe formé par une pluralité de personnes.
Dans ce cas, l'unité du groupe s'objective elle-même dans un groupe:
c'est ainsi que la communauté
religieuse s'incarne dans le clergé; la société politique,
dans l'administration ou dans l'armée (selon qu'il s'agit de sa vie
intérieure ou de ses relations
avec le dehors); l'armée, à son tour, dans le corps des officiers,
toute association durable
dans son comité, toute réunion passagère dans son bureau, tout parti
politique dans sa représentation parlementaire.
La constitution de ces organes est le résultat d'une division
du travail sociologique.
Les relations interindividuelles, qui
sont la trame de la vie sociale et dont la forme spéciale détermine
le caractère du groupe, s'exercent primitivement sans intermédiaire,
de particulier à particulier.
L'unité d'action se dégage alors de débats directs entre les agents et d'une mutuelle
adaptation des intérêts; l'unité
religieuse, du besoin qui pousse chacun à communier dans une
croyance; l'organisation militaire,
de l'intérêt qu'a tout homme valide soit à se défendre, soit à
attaquer; la justice publique, des sentences immédiates de la
foule assemblée; la subordination
politique, de la supériorité
personnelle d'un individu sur ses associés; l'harmonie économique,
des échanges directs entre producteurs2.
2
Je ne veux pas affirmer que cet état, le plus simple logiquement,
ait été réellement partout le point de départ historique de tout
développement social ultérieur. Mais, pour déterminer ce qui est dû
à la constitution d'organes sociaux différenciés, il faut supposer
cet état antérieur, ne fût-il qu'une fiction. Et, dans bien des cas,
c'est une réalité.
Mais bientôt,
ces
fonctions, au lieu d'être exercées par les intéressés eux-
mêmes, deviennent l'office
propre de groupes spéciaux et déterminés.
Chaque individu, au lieu d'agir directement sur les
autres, entre en relations
immédiates avec ces organes nouvellement formés.
En d'autres termes, tandis
que, là où ces organes ne se sont pas formés, les éléments individuels ont seuls une
existence substantielle et ne
peuvent se combiner que suivant
des rapports purement
fonctionnels, leur combinaison, en
s'organisant ainsi, acquiert une
existence sui
generis;
elle est désormais indépendante, non pas seulement des membres du
groupe auxquels cette
organisation s'applique, mais encore des
personnalités particulières qui
ont pour tâche de la représenter et d'en assurer le
fonctionnement.
Ainsi, la classe des
commerçants, une fois constituée, est une réalité autonome qui, en
dépit de la mobilité des
individus, remplit d'une manière uniforme
son rôle d'intermédiaire entre
les producteurs.
Le
corps des
fonctionnaires apparaît plus clairement encore comme une
sorte de moule objectif où les individus ne font que passer et
qui
réduit assez souvent à rien leur personnalité.
De
même, l'État se
charge de faire collectivement les sacrifices pécuniaires
que les différentes parties de la
société exigent les unes des autres et, inversement, par
l'intermédiaire d'agents spéciaux, il
astreint les unes et les autres
aux mêmes obligations fiscales.
De
même encore,
l'Église est un organisme impersonnel dont les fonctions sont
exercées par les prêtres, sans être créées par eux.
En
un mot, l'idée qu'on a crue fausse des êtres vivants, à savoir
que les interactions de molécules matérielles, dont l'ensemble
constitue la vie, ont pour support un principe vital distinct,
cette idée est expressément vraie des êtres sociaux.
Ce
qui, à
l'origine, consistait simplement en échanges interindividuels,
se
façonne à la longue des organes spéciaux qui, en un sens,
existent par eux-mêmes.
Ils
représentent les idées et les forces
qui maintiennent le groupe dans telle ou telle forme déterminée
et, par une sorte de condensation, ils font passer cette
forme de l'état purement fonctionnel à celui de réalité substantielle.
C'est un des faits les plus caractéristiques de l'humanité et
des plus profondément invétérés dans notre nature que cette
faculté qu'ont les individus comme les groupes de tirer des
forces nouvelles de choses qui tiennent d'eux-mêmes toute leur
énergie.
Les forces vitales du sujet prennent souvent ce détour
pour mieux servir à sa conservation et à son développement; elles se
construisent un objet fictif d'où elles reviennent, en quelque
sorte, sur le sujet d'où elles émanent.
C'est ainsi que, dans certaines guerres, on voit un des belligérants
contracter
une alliance, mais en prêtant au préalable à son allié les forces
avec lesquelles il en sera secouru.
Qu'on se rappelle ces dieux
que les hommes ont créés en sublimant les qualités qu'ils
trouvaient en eux-mêmes, et dont ils attendent ensuite et une
morale et la force de la pratiquer! Qu'on se rappelle ces paysages
dans lesquels nous projetons nos états d'âme de toute
sorte, pour en recevoir un peu après des consolations et des
encouragements! Combien de fois encore des amis, des femmes
ne nous paraissent-ils pas
singulièrement riches de sentiments
et d'idées, jusqu'au moment où
nous nous apercevons que
toute cette richesse morale vient de nous et n'est qu'un reflet
de la nôtre! Si nous nous
dupons de la sorte, ce n'est sûrement pas sans raison.
Beaucoup des
forces de notre être ont besoin de
se projeter, de se métamorphoser, de s'objectiver ainsi pour
produire leur maximum
d'effet; il faut que
nous les placions à une
certaine distance de nous pour qu'elles agissent sur nous avec leur
plus grande force, et l'illusion où nous sommes sur
leur origine a justement pour
utilité de ne pas troubler leur action.
Or les organes différenciés que crée la société sont
souvent des produits de ce genre.
Les énergies collectives s'y
trouvent concentrées sous une forme spéciale qui, en vertu de
ses caractères
propres, résiste au groupe dans son ensemble; si
l'intérêt social l'exige, des
forces sui
generis
semblent s'en
dégager, qui ne sont
pourtant qu'une transformation de ces forces élémentaires sur
lesquelles elles réagissent.
Quelle est l'importance de ces organes pour la conservation des
groupes? C'est ce qu'un exemple va montrer.
La décadence
des anciennes corporations de l'Allemagne vint en partie de ce
qu'elles ne surent pas se constituer d'organes.
Elles restèrent
identiques à la somme de leurs membres; elles ne parvinrent pas
à élever au-dessus des individus une organisation objective en
qui s'incarnât l'unité sociale.
Elles avaient bien des représentants, munis de pouvoirs spéciaux,
mais qui avaient un caractère
trop étroitement individuel; c'étaient simplement des personnes
sûres à qui l'on confiait les fonctions les plus indispensables
à l'existence commune.
Sans doute, il arriva çà et là
que ces délégations se transformèrent plus tard en organes
permanents de la vie publique;
mais, à l'origine, cette transformation
n'eut pas lieu.
L'unité du groupe resta sous la dépendance
immédiate des interactions individuelles; elle ne se
condensa ni en un État dont l'idée aurait plané au-dessus des
générations appelées successivement à le représenter, ni en
organes particuliers qui, chargés
de fonctions déterminées, en auraient, du moins, débarrassé
l'ensemble des travailleurs.
Or, les dangers qui résultent de cette situation peuvent être
classés sous trois chefs:
I°
Là où il y a des organes différenciés, le corps social est plus
mobile.
Tant que, pour chaque mesure politique, juridique,
administrative, il doit tout
entier se mettre en branle, son action
pèche par la lourdeur, et cela
doublement.
D'abord, en un sens tout matériel. En effet, pour que le groupe
entier puisse agir
collectivement, il faut, avant tout, qu'il soit assemblé; et la
difficulté, parfois même l'impossibilité d'un rassemblement
total empêche mille décisions ou en diffère d'autres jusqu'au
moment où il est trop tard.
Mais supposons levée cette difficulté extérieure de la concentration
physique, alors se dresse celle
de la concentration morale.
Comment arriver, dans une
masse si considérable, à l'unanimité? Quand une foule se meut,
ses mouvements sont alourdis par toute sorte d'hésitations, de
considérations qui tiennent soit à la divergence des intérêts
particuliers, soit à l'indifférence des individus.
Au contraire, un
organe social peut s'affranchir de tous ces impedimenta,
parce
qu'il est fait pour un but défini et qu'il est composé d'un
nombre de personnes relativement restreint, et ainsi il contribue
à la conservation du groupe en rendant l'action sociale plus
précise et plus rapide.
C'est à ces difficultés que doit être attribuée l'inaptitude de la
foule à agir dans les cas où, pourtant, l'action n'exige ni connaissances
ni qualités spéciales.
Par exemple, un règlement d'administration, rendu vers la fin du XVe
siècle pour le cercle de Durkheim, parle d'affaires »trop nombreuses et trop compliquées
pour pouvoir être traitées par la commune tout entière; huit personnes capables avaient alors été choisies dans le
sein de la commune et chargées
d'agir en ses lieu et place«.
Ainsi, dans un grand nombre de circonstances, l'intérêt qu'il y a
à faire représenter une multitude par une minorité vient de ce
qu'un groupe plus restreint, simplement parce qu'il est plus
restreint et indépendamment de toute supériorité qualitative, a
plus de liberté dans ses mouvements, plus de facilité pour se
réunir, plus de précision dans ses actes.
La même cause peut ralentir les relations économiques quoique,
dans ce cas, le groupe n'ait pas besoin de se réunir en corps
pour agir.
Tant que l'achat et la vente ont lieu directement entre
producteurs et consommateurs, les échanges sont considérablement
gênés par cette nécessité où sont les individus de se
rencontrer en un même lieu.
Mais une fois que le commerçant
commence à jouer son rôle d'intermédiaire, une fois surtout
que la classe des commerçants, systématisant l'échange, met les
intérêts économiques en contact d'une manière continue, la
cohésion sociale devient beaucoup plus forte.
L'organe nouveau, qui s'intercale
ainsi entre les éléments primaires du
groupe, est, comme la mer entre
deux pays, principe d'union,
non de séparation: car, par la
manière dont elle agit, la classe des commerçants met chacun
plus étroitement en rapports avec
tous.
De plus, en durant, cette activité donne naissance à un système de
fonctions régulières qui se balancent harmoniquement,
sorte de forme abstraite qui enveloppe les faits particuliers
de consommation et de production, mais les dépasse,
comme l'État dépasse les citoyens et l'Église les croyants.
Un cadre est ainsi constitué dans lequel les relations économiques
se développent et qui est susceptible d'une extension
presque indéfinie; et la manière dont ces relations se multiplient,
jointe à la persistance de cette organisation à mesure que le
mouvement économique s'accélère, prouve assez combien
ces organes spéciaux importent à
la durée de l'unité collective et
combien sont insuffisantes, dans
ce but, des interactions purement individuelles.
2° En second lieu, dans tous les cas où la totalité du groupe doit
se mettre en mouvement pour chaque fin sociale particulière,
sans qu'aucune de ses parties soit encore différenciée, des
tiraillements intérieurs ne peuvent manquer de se produire, car,
comme tous les éléments ont a priori la même valeur et la
même
influence, tout moyen de décider entre eux fait défaut.
Cet état
se trouve réalisé d'une manière tout à fait typique dans ces
sociétés où la majorité
elle-même n'a pas le pouvoir d'imposer
ses volontés, où chaque opposant a le droit ou d'empêcher par son veto
toute résolution commune d'une façon générale ou de ne pas s'y
soumettre personnellement.
A ce péril qui menace
jusqu'à l'unité intérieure du groupe, la création d'organes
spéciaux remédie, pour le moins, de deux manières.
D'abord, un corps de
fonctionnaires, une commission aura plus de
connaissances spéciales que la foule et, par ce moyen déjà,
les frottements et les conflits
qui résultent simplement de
l'incompétence, seront atténués.
L'action est toujours plus
une quand une connaissance objective de la situation ne laisse pas
de place aux hésitations de l'agent.
Mais un autre avantage,
lié pourtant au premier, est moins aisé à découvrir.
Si une insuffisante objectivité empêche souvent la multitude d'agir
avec ensemble (car les erreurs subjectives sont en nombre
infini, tandis que la vérité, étant une, ne peut être l'objet
d'opinions divergentes), la cause n'en est pas toujours la
pure et simple incompétence.
Un autre facteur, fort important, peut intervenir.
La division des partis, qui se fait d'abord sur un
petit nombre de questions essentielles, s'étend ensuite à d'autres
qui sont sans liens avec les précédentes, et l'accord des esprits
devient impossible en principe.
Ainsi, les partis politiques forment à propos des questions religieuses, esthétiques,
etc., des camps opposés, quand
même leur opposition sur ce terrain serait sans rapport avec l'objet
de leur opposition première.
Les luttes des partis ont donc pour conséquence un
monstrueux gaspillage de forces
qui cesse dès que, au lieu
d'abandonner toutes les questions aux discussions confuses de la
foule, on les fait résoudre, toutes les fois qu'elles s'y
prêtent, par des organes particuliers.
3° Enfin, un troisième avantage de cette organisation consiste
dans la meilleure direction qu'elle donne aux forces collectives.
En effet, les foules, dans leurs manières d'agir, ne peuvent
jamais s'élever au-dessus d'un niveau intellectuel assez bas, car
le point où se rencontrent un
grand nombre d'esprits ne saurait être situé très au-dessus
de celui où s'arrêtent les plus médiocres.
Qui peut le plus peut le moins, dit-on; mais la réciproque
n'est pas vraie, et c'est pourquoi ce sont les éléments les plus
inférieurs, et non les plus élevés, qui donnent le ton à l'ensemble.
Cette règle, il est vrai, ne s'applique pas à ce qui concerne
l'intensité de la vie affective; car, dans une foule assemblée, il
se
produit comme une nervosité collective, une surexcitation mutuelle
des individus qui peut momentanément élever la
passion commune au-dessus de l'intensité moyenne des passions
individuelles. Mais les sentiments ainsi renforcés sont-ils
ou non adaptés à telle fin,
sont-ils sages ou fous? C'est une
tout autre question. Le
caractère plus ou moins intelligent des
décisions prises ainsi ne peut
pas dépasser une moyenne où les
mieux doués viennent rejoindre les moins capables. La réunion des
individus peut bien accroître les puissances du sentiment et
du vouloir, non celles de
l'entendement. Sans doute, quand la
société, pour se maintenir, n'a
besoin que des actions et réactions directement échangées entre
individus, il suffit que chaque
intelligence particulière donne tout ce qu'elle peut donner.
Mais il en va tout autrement
quand le groupe doit agir comme
unité. Là, c'était d'un mouvement
moléculaire, ici, c'est d'un mouvement en masse qu'il s'agit;
dans le premier cas, il n'était
ni possible ni désirable que les individus se fissent représenter;
dans le second, cette représentation devient possible et nécessaire. Quand un groupe étendu veut conduire lui-même e
directement ses affaires, il est indispensable que chacun de ses
membres comprenne et approuve, dans une certaine mesure,
les règles d'action qu'il suit;
elles sont donc condamnées à une
sorte de trivialité.
C'est seulement lorsque les questions sont
laissées à une organisation composée d'un nombre restreint de
personnes, que le talent peut se donner carrière.
A mettre les choses au mieux, comme les aptitudes spéciales et les
compétences ne sont jamais communes qu'à une minorité, quand elles
se produisent au sein d'une assemblée un peu vaste, il leur faut
conquérir de haute lutte une influence qui leur est accordée
sans conteste dans un organe différencié3.
3
Sans doute, les choses ne se passent pas toujours ainsi. Dans un
corps de fonctionnaires, la jalousie enlève souvent au talent
l'influence qui
devrait lui revenir, tandis qu'une foule, renonçant à tout jugement
personnel, suivra aisément un meneur de génie. Il est inévitable
qu'une science abstraite, comme la sociologie, ne puisse pas épuiser
la complexité des faits
historiques. Quelle que soit la réalité des lois qu'elle
établit, les événements concrets impliqueront toujours des
séries d'autres causes dont
l'influence peut, dans l'effet total, dissimuler l'action de
la première.
Ces inconvénients réunis n'ont pas seulement pour résultat de livrer
une société, dépourvue d'organes différenciés, aux
causes de dissolution que toute
structure sociale porte en elle- même; ils la mettent aussi
en état d'infériorité toutes les fois
qu'elle entre en lutte contre
des puissantes individualités.
C'est ce qui perdit ces vieilles corporations allemandes dont nous
parlions tout à l'heure; elles furent incapables de tenir tête à ces
pouvoirs personnels qui, pendant ou après le moyen âge, se
constituèrent soit au centre du pays soit sur des points secondaires.
Elles périrent parce qu'il leur manqua ce que seules des
forces individuelles, constituées à l'état d'organes sociaux, peuvent
assurer à une société, je veux dire la rapidité des décisions,
la concentration absolue de toutes les puissances de l'esprit, et
cette intelligence supérieure dont les individus sont seuls capables,
que ce soit l'ambition qui les pousse ou le sentiment de
leur responsabilité.
Toutefois, il importe également à la conservation du groupe
que ces organes ne se spécialisent pas au point de parvenir à une
absolue autonomie.
Il faut qu'on sente toujours avec force, au
moins d'une manière sourde, ce qu'ils sont véritablement; à
savoir, qu'ils ne représentent en définitive que des abstractions
réalisées, que les interactions
individuelles en sont tout le
contenu concret, qu'ils sont
simplement la forme sous laquelle se sont pratiquement
organisées ces forces élémentaires, au
cours de leur développement.
Tout ce qu'ils expriment, c'est la manière dont les unités primaires
du groupe mettent en
œuvre leurs énergies latentes, quand elles atteignent leur plus
grande puissance d'action.
Si donc, en se différenciant, ils se
détachent de l'ensemble, leur action, de conservatrice, devient
destructive.
Deux raisons principales peuvent déterminer cette transformation.
D'abord, si l'organe développe avec excès sa vie
personnelle, s'il s'attache moins à l'intérêt social qu'au sien
propre, ses efforts pour se conserver entreront naturellement
en conflit avec ceux de la
société.
La bureaucratie nous offre de
cet antagonisme un exemple, relativement inoffensif, mais significatif.
Les bureaux, ces organes nécessaires de toute administration
un peu étendue, forment par eux-mêmes un système
qui entre souvent en collision avec les besoins variables de la vie
sociale, et cela pour plusieurs raisons.
D'abord, la compétence
des bureaux ne peut s'étendre à la complexité de tous les cas
individuels, même de ceux qui sont de leur ressort.
Ensuite, entre le temps employé à
mettre en branle la machine bureaucratique et le caractère
urgent des mesures à prendre, il y a
souvent une criante
disproportion.
Si donc un organe, qui
fonctionne si lourdement, en vient, de plus, à oublier son
rôle d'organe et se pose comme une fin en soi, alors il n'y a
plus seulement différence, mais opposition directe entre ses
intérêts et ceux de la société.
La partie ne peut plus se maintenir
qu'aux dépens du tout, et réciproquement.
On pourrait comparer sur ce point la forme bureaucratique aux formes
logiques
de l'entendement.
Celles-ci sont à la connaissance du réel ce
que celle-là est à l'administration de l'État; c'est un instrument
destiné à organiser les données de l'expérience, mais qui, précisément,
n'en peut être séparé sans perdre tout sens et toute
raison d'être.
Quand la logique, perdant le contact avec la
matière des faits dont elle n'est que l'expression schématique,
prétend tirer d'elle-même une science qui se suffise, le monde
qu'elle construit et le monde réel se contredisent nécessairement.
Par elle-même, elle est seulement un moyen pour arriver à la
connaissance des choses; si donc, oubliant son rôle de
moyen, elle veut s'ériger en un
système complet de la connaissance, elle devient un obstacle aux
progrès de la science, comme
la bureaucratie, quand elle perd
de vue sa véritable fonction,
devient une gêne pour la société dont elle est l'organe.
Le droit lui-même n'échappe pas toujours à cette excessive
cristallisation.
Primitivement, il n'est rien de plus que la forme
des interactions individuelles; il exprime ce qu'elles sont tenues
d'être pour que le lien social puisse se maintenir.
A lui seul,
il ne suffit nullement à assurer la vie et, encore moins, le progrès
de la société; mais il est le minimum indispensable à la conservation
du groupe.
Il résulte d'une organisation à deux degrés.
D'abord, des actes que les individus réclament les uns des
autres et qu'ils accomplissent réellement, au moins la plupart
du temps, se dégage le précepte juridique, forme abstraite de la
conduite, qui en devient, dans l'avenir, la norme régulatrice.
Mais ce premier organe, tout idéal en quelque sorte, a besoin,
pour pouvoir résister aux forces qui l'assaillent, de se compléter
par un autre, plus concret et plus matériel.
Des raisons purement
techniques mettent fin à cet état d'homogénéité primitive
où c'était soit le pater familias soit la foule assemblée qui
disaient le droit; dès lors, il devient nécessaire qu'une classe
se constitue pour imposer ces normes aux relations individuelles.
Mais si utile, si indispensable même que soit cette double
organisation, elle expose les sociétés à un grave danger: la fixité
d'un tel système peut se trouver en opposition avec la complexité
croissante des rapports individuels et avec les besoins
plus mobiles de la société.
Tant par sa cohésion interne que par
le prestige de ceux qui l'appliquent, le Droit acquiert plus que la
juste indépendance qui est conforme à sa fin; par un véritable
cercle vicieux, il s'arroge à lui-même je ne sais quel droit à
rester
tel quel, envers et contre tout.
Or il peut se faire qu'au même
moment la société, pour se maintenir, ait besoin que le droit
varie; c'est alors que naissent
ces situations fausses dont les
formules connues:
Fiat
justitia,
pereat mundus, ou summum
jus, summa injuria
sont l'expression.
C'est pour assurer au
droit la plasticité indispensable à son rôle d'organe, qu'on laisse
au juge une sorte de marge dans l'interprétation et l'application
des lois; et c'est à la limite de cette marge que se trouvent les
cas
où il faut résolument choisir entre le salut du droit et celui de
l'État.
Nous n'en rappelons ici l'existence que pour montrer,
par un nouvel exemple, comment un
organe social, en s'immobilisant dans son autonomie, en se
considérant lui-même comme un tout, peut devenir un danger
pour le tout.
Qu'il s'agisse de la bureaucratie ou du formalisme juridique,
cette transformation d'un moyen en fin est d'autant plus dangereuse
que le moyen est, d'après les apparences, plus utile à
la société.
La situation sociale des militaires nous en offre
un exemple.
Instituée pour des fonctions spéciales, l'armée,
pour des raisons techniques, doit former un organisme aussi
indépendant que possible.
Pour obtenir de ses membres les
qualités qu'elle réclame et, principalement, une étroite solidarité,
il faut qu'elle les sépare radicalement de toutes les autres
classes; c'est à quoi servent et
l'uniforme et l'honneur spécial au
corps des officiers.
Or, quoique cette indépendance soit exigée
par l'intérêt général, elle peut devenir tellement absolue et
exclusive que l'armée finit par constituer un État dans l'État,
détaché du reste de la nation, sans contact, par conséquent, avec
la source dernière de sa force.
C'est ce péril que l'on cherche à
conjurer aujourd'hui par l'institution d'armées nationales; le
service temporaire de tous les
citoyens est certainement un bon
moyen pour obliger l'armée à se
renfermer dans son rôle d'organe.
Mais pour éviter les antagonismes possibles entre le groupe
et ses organes, il ne suffit pas de ne laisser à ces derniers qu'une
indépendance limitée; il faut encore qu'en cas de nécessité ils
puissent rétrocéder à l'ensemble la fonction qu'ils en ont, en
quelque sorte, détachée.
L'évolution des sociétés a ceci de particulier que leur conservation
exige parfois la régression momentanée d'organes déjà différenciés.
Cette régression, toutefois, diffère de celle
que subissent les organes des être vivants à la suite de changements
dans leurs conditions d'existence, comme l'atrophie des
yeux chez les animaux qui restent longtemps dans des lieux
obscurs.
En effet, dans des cas de ce genre, c'est l'inutilité de la fonction
qui entraîne la disparition progressive de l'organe; au
contraire, dans le cas des sociétés, c'est parce que la fonction est
nécessaire et l'organe insuffisant qu'il faut revenir aux actions
et réactions immédiatement échangées entre les individus.
Parfois
même, la société est, dès l'origine, constituée de manière à
ce que la même fonction soit alternativement exercée par les
éléments primaires et par l'organe différencié.
Telles sont les sociétés d'actionnaires dans lesquelles la partie
technique des
affaires est remise à des directeurs, que l'assemblée générale a
pourtant le droit de déposer et auxquels elle peut prescrire
certaines mesures dont ils
n'auraient même pas eu l'idée ou
qu'ils n'étaient pas autorisés à
prendre spontanément.
D'autres
associations, plus petites, tout en confiant à un président ou à
un comité le soin de leurs
affaires, prennent leurs dispositions
pour que, au besoin, de gré ou de
force, ces fonctionnaires se
démettent de leurs fonctions dès
qu'ils ne sont plus en état de
s'en acquitter.
Toutes les révolutions par lesquelles un groupe
politique, renversant son gouvernement, replace la législation
et l'administration sous la dépendance immédiate des initiatives
individuelles, sont des phénomènes sociologiques du même
genre.
Il est évident, d'ailleurs, que de pareilles régressions ne
peuvent se produire indifféremment dans toute espèce de sociétés.
Quand les sociétés sont très grandes ou très complexes,
ce retour du gouvernement à la masse est absolument impossible.
L'existence d'organes différenciés est un fait sur lequel il
n'y a plus moyen de revenir; tout ce qu'on peut souhaiter, c'est
qu'ils restent assez plastiques pour permettre la substitution
d'autres personnes à celles qui sont en fonction, si ces dernières
se montrent incapables.
Toutefois, il y a des sociétés qui sont
déjà parvenues à un assez haut développement et où, néanmoins, on
observe de ces faits d'évolution régressive, mais
seulement à titre transitoire et
tandis qu'une organisation nouvelle est en train de s'élaborer.
Ainsi, l'Église épiscopale, dans
l'Amérique du Nord, souffrit jusqu'à la fin du siècle dernier de
l'absence d'évêque.
L'Église mère d'Angleterre qui, seule, pouvait
en consacrer, se refusait à le faire pour des motifs politiques.
Alors l'urgence extrême, le danger d'une dispersion irrémédiable
décidèrent les fidèles à se tirer d'affaire eux-mêmes.
En 1784, ils nommèrent des délégués, prêtres et laïques, dont la
réunion constitua une Église suprême, organe central et directeur
de toutes les Églises particulières.
Un historien de l'époque
décrit la chose ainsi: »Ce fut un spectacle vraiment étrange, et
sans analogue dans l'histoire du christianisme, que cette assemblée
d'individus constituant d'eux-mêmes une unité spirituelle
sous la pression de la nécessité.
Dans tous les autres cas, c'est
l'unité de l'épiscopat qui faisait celle des fidèles; chacun ressortissait
manifestement à la communauté dont l'évêque était la
tête.« Ainsi l'union des croyants, qui jusque-là avait trouvé
dans l'organisation épiscopale une sorte de substrat indépendant,
retourna à son essence primitive.
Les éléments ressaisirent cette force qu'ils avaient tirée
d'eux-mêmes et qui paraissait maintenant leur revenir du dehors.
Le cas est d'autant plus intéressant que la qualité nécessaire
pour maintenir l'unité des fidèles, l'évêque la reçoit par la
consécration, c'est-à-dire d'une source qui paraît située en dehors
et au-dessus de toutes les fonctions sociales.
Mais le
fait qu'elle a pu être remplacée par un procédé purement
sociologique
montre bien d'où elle venait en réalité.
Ce fut
simplement une preuve de la merveilleuse santé politique et
religieuse de ces populations
que la facilité avec laquelle elles remplacèrent une
organisation aussi ancienne, en se ressaisissant
des forces sociales qui avaient servi à la faire et en les
mettant en œuvre sans
intermédiaire.
Beaucoup de sociétés ont,
au contraire, péri parce que les relations entre leurs forces
élémentaires et les organes qui en étaient sortis n'avaient pas
gardé assez de plasticité pour que les fonctions de ces derniers
pussent, en cas de disparition ou de décadence, faire retour à la
masse.
V
Les organes différenciés sont comme des substrats qui aident
à la consolidation des groupes; la société, en les acquérant,
s'enrichit de membres nouveaux.
Mais, si l'on se place au point
de vue de la fonction et non plus au point de vue de l'organe,
comment l'instinct de conservation des groupes détermine-t-il leur
activité? C'est une tout autre question.
Que cette activité
s'exerce par la masse indistincte des individus ou par des organes
spéciaux, c'est, à cet égard, un point secondaire.
Ce qui importe
ici, c'est la forme générale et le rythme selon lesquels ont lieu
les
processus vitaux de la société.
Deux cas principaux se présentent. Le groupe peut se maintenir soit
en conservant le plus
fermement possible ses formes, une fois fixées, de telle sorte qu'il
oppose une résistance quasi matérielle aux dangers qui le menacent
et garde, au milieu des circonstances les plus variées, la
même constitution interne.
Mais il peut arriver au même résultat
en variant ses formes, de telle sorte qu'elles répondent aux
changements des circonstances
externes par leurs changements
intérieurs et puissent, grâce à cette mobilité, se plier à tous les
besoins.
Cette dualité de procédés correspond sans doute à
quelque trait général de la
nature, car on en retrouve l'analogue jusque dans le monde physique.
Un corps résiste à la dispersion
dont le menacent les chocs, soit par sa dureté et une cohésion
tellement massive de ses éléments que l'assaut des forces
extérieures ne change rien à leurs rapports, soit par sa plasticité
et
son élasticité, qui cède, sans doute, à la moindre pression, mais,
en revanche, permet au corps de reprendre aussitôt après sa
forme première.
Étudions donc l'un et l'autre de ces procédés
d'autoconservation sociale.
Le procédé purement conservateur paraît surtout convenir
aux sociétés faites d'éléments disparates et travaillées par des
hostilités latentes ou déclarées.
Dans ce cas, toute secousse,
d'où qu'elle vienne, est un danger; même les mesures les plus
utiles, s'il en doit résulter un ébranlement quelconque, doivent
être évitées.
C'est ainsi qu'un État très compliqué et dont
l'équilibre est perpétuellement instable, comme l'Autriche,
doit être, en principe, fortement conservateur, tout changement
pouvant y entraîner des troubles irréparables.
C'est même,
d'une manière générale, l'effet que produit l'hétérogénéité
des éléments dans les grandes sociétés, tant que cette hétérogénéité
ne sert pas, au contraire, à renforcer, grâce à une
harmonieuse division du travail, l'unité intérieure.
Le danger vient de ce que, dans
les couches différentes, et parfois même de
tendances opposées, dont est
fait un pareil État, le moindre
ébranlement doit nécessairement avoir les contrecoups les plus variés.
Plus la cohésion intérieure du groupe est faible,
plus aussi toute nouvelle excitation de la conscience sociale,
tout appel aux réformes publiques, risquent d'augmenter encore
les oppositions; car il y a mille routes par où les hommes
peuvent diverger les uns des autres et, très souvent, une seule
qui leur permette de se rencontrer.
C'est pourquoi, alors même
qu'un changement, par lui-même, pourrait être utile, il aurait
toujours l'inconvénient de mettre en relief l'hétérogénéité des
éléments, comme la simple prolongation de lignes divergentes
rend plus sensible leur divergence4.
4
Que l'ébranlement produit par les guerres serve souvent à restaurer
la cohésion sociale et, par conséquent, à maintenir les formes de
l'État, l'exception n'est
qu'apparente et, en réalité, confirme la règle.
Car la guerre fait précisément
appel aux énergies qui sont communes
aux éléments, même les plus
opposés du groupe; par suite, elle met si bien en lumière
leur caractère vital que la secousse sociale annule d'elle-même,
dans ce cas, ce qui la rend dangereuse, à savoir la
divergence des éléments. Mais là
où elle n'est pas assez forte pour
triompher des dissensions
internes, alors la guerre exerce la même action que tous les autres
ébranlements sociaux. Que de fois elle a donné le dernier coup à des
États intérieurement divisés! Que de
groupes, même en dehors des
sociétés politiques, se sont trouvés, par
suite de leurs conflits
intérieurs, dans cette alternative ou d'oublier, pour
combattre, leurs querelles intestines, ou de se laisser mourir
sans résistance.
Le même conservatisme s'impose toutes les fois qu'une
forme sociale survit tout en ayant perdu sa raison d'être et
quoique les éléments, qui en étaient la matière, soient tout prêts
à entrer dans des combinaisons sociales d'autres sortes.
A partir
de la fin du moyen âge, les corporations, en Allemagne, furent
peu à peu dépouillées de leur influence et de leurs droits par les
progrès des puissances centrales.
Elles perdirent la force de
cohésion qu'elles avaient eue jusque-là et qu'elles devaient à
l'importance de leur rôle social; mais elles en gardaient encore
l'apparence et le masque.
Dans ces conditions, elles ne pouvaient
attendre leur salut que d'un exclusivisme étroit qui en fermât
l'accès.
En effet, tout accroissement quantitatif d'une
société entraîne des modifications qualitatives, nécessite des
adaptations nouvelles qu'un être social vieilli ne peut supporter.
Les formes des groupes dépendent étroitement du nombre
des éléments; telle structure qui convient à une société d'un
effectif déterminé, perd sa valeur si cet effectif augmente.
Mais
ces transformations internes et tout le travail nécessaire pour
assimiler les membres nouveaux ne vont pas sans de grandes
consommations de forces.
Or des groupes qui ont perdu toute
signification n'ont plus de force disponible pour une pareille
tâche; ils ont besoin de tout ce qui leur en reste pour protéger
contre les dangers du dehors et ceux du dedans la forme sous
laquelle ils existent.
Voilà pourquoi les corporations s'interdirent
d'accepter des membres nouveaux.
Ce n'était pas seulement
pour fixer directement les dimensions du groupe en le
limitant aux membres alors existants et à leur postérité; mais
encore pour éviter ces changements de structure qu'implique
indirectement tout accroissement de grandeur et qu'une société
sans raison d'être est hors d'état de supporter.
Quand une association quelconque
est dans cette situation, l'instinct de conservation suffit à
la rendre étroitement conservatrice.
Cette tendance se rencontre surtout dans des groupes incapables de
soutenir la concurrence de leurs rivaux.
Car, pendant
que leur forme est en train de muer, qu'ils sont en voie de
devenir, ils prêtent le flanc aux coups de l'adversaire.
C'est dans
la période
intermédiaire entre deux états d'équilibre que les
sociétés, comme les individus,
sont le moins en état de se
défendre.
Quand on est en mouvement, on ne peut pas se
protéger de tous côtés comme quand on est au repos.
C'est
pourquoi un groupe, qui se sent menacé par ses concurrents,
évitera, pour
se conserver, toute espèce de transformation.
Quieta non movere
sera sa devise.
Nous arrivons
maintenant à l'examen des cas où c'est, tout au contraire,
l'extraordinaire plasticité des formes sociales qui
est nécessaire à leur permanence.
C'est ce qui arrive, par
exemple, à ces cercles dont l'existence, au sein d'un groupe
plus étendu, n'est que tolérée ou même ne se maintient que par
des
procédés illicites.
C'est
seulement grâce à une extrême
élasticité que de pareilles sociétés peuvent, tout en gardant
une consistance suffisante, vivre
dans un état de perpétuelle défensive ou même, à l'occasion, passer
rapidement de la défensive
à l'offensive et réciproquement.
Il faut, en quelque sorte, qu'elles se glissent dans toutes les
fissures, s'étendent
ou se contractent suivant les circonstances et, comme un fluide,
prennent toutes les formes possibles.
Ainsi, les
sociétés de conspirateurs ou
d'escrocs doivent acquérir la faculté de se
partager instantanément et d'agir
par groupes séparés, de se
subordonner pleinement tantôt à
un chef et tantôt à un autre, de
conserver le même esprit commun,
que tous leurs membres soient immédiatement en contact ou
non, de se reconstituer sous une
forme quelconque après une dispersion, etc.
Voilà
comment elles arrivent à se maintenir avec une persistance qui
faisait dire aux Bohémiens: »Inutile de nous pendre, car nous ne
mourrons jamais.« On a tenu le même langage à propos des
Juifs.
Si, dit-on, le sentiment de solidarité qui les rattache si
étroitement
les uns aux autres, si cet esprit d'exclusivisme à
l'égard des autres cultes, qui
leur est propre quoiqu'il se soit souvent relâché, si tous ces liens
sociaux ont perdu, depuis
l'émancipation du Judaïsme, leur
couleur confessionnelle, c'est
pour en prendre une autre: c'est maintenant le capitalisme qui
les unit.
Leur organisation est indestructible précisément parce
qu'elle n'a pas de formes définies et tangibles.
On aura beau,
répète-t-on, leur retirer la puissance de la presse, celle du
capital,
l'égalité des droits avec les autres citoyens; la société
juive ne sera pas abattue pour
cela.
On pourra bien leur enlever
ainsi leur
organisation politique et sociale; mais on restaurera du même coup
leur union confessionnelle. Ce jeu de bascule,
qui leur a réussi sur plus d'un
point, est parfaitement susceptible
de se généraliser.
On pourrait encore aller plus loin et
montrer dans
la plasticité personnelle du Juif, dans sa remar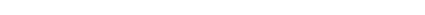 quable
aptitude à se faire aux tâches les plus diverses, à s'adapter
aux conditions d'existence les plus opposées, comme un
reflet individuel des caractères
généraux du groupe. quable
aptitude à se faire aux tâches les plus diverses, à s'adapter
aux conditions d'existence les plus opposées, comme un
reflet individuel des caractères
généraux du groupe.
Mais quoi qu'il en soit et que ces affirmations s'appliquent
réellement ou non à l'histoire du peuple juif, le fait qu'on a pu
les croire vraies est déjà pour nous un enseignement.
Il nous rappelle que la mobilité des formes sociales peut être une
condition de leur
permanence.
Si nous cherchons maintenant quels rapports ces deux procédés
contraires soutiennent avec les formes les plus générales
de l'organisation sociale, nous allons voir se dérouler une série
d'oppositions caractéristiques.
On sait que l'existence d'un
groupe est souvent liée à celle d'une classe déterminée, au point
de ne pouvoir se maintenir si cette classe ne se maintient et avec
tous ses caractères spécifiques; c'est tantôt la plus élevée,
tantôt la plus nombreuse, tantôt enfin la classe intermédiaire qui
joue ce rôle.
Or, dans les deux premier cas, c'est l'immobilité des formes
sociales qui s'impose; dans le troisième, c'est, au contraire,
leur élasticité.
Les aristocraties sont généralement conservatrices. Supposons,
en effet, qu'elles soient réellement ce que leur nom
signifie,
c'est-à-dire la domination des meilleurs; elles expriment
alors sous la forme la plus adéquate possible l'inégalité de
fait qui existe entre les hommes.
Or, dans ce cas — je ne
recherche pas s'il s'est jamais réalisé, sauf très partiellement —
l'aiguillon qui pousse aux révolutions fait défaut; c'est, à savoir,
cette disproportion entre la valeur intrinsèque des personnes et
leur situation sociale, qui peut susciter aussi bien les plus nobles
que les plus folles entreprises.
Par conséquent, même dans cette
hypothèse, c'est-à-dire quand l'aristocratie est placée dans les
conditions les plus favorables où elle puisse être, elle ne peut
durer qu'en fixant d'une manière rigide et l'étendue de ses
cadres et leur mode d'organisation.
Le moindre essai de dérangement menacerait, sinon en réalité, du
moins dans l'esprit des
intéressés, cette rare et exquise proportion qui existe par hypothèse
entre les qualités des individus et leur place dans la
société; par suite, un premier germe de révolution serait constitué.
Mais ce qui sera toujours, dans toutes les aristocraties, la
cause principale de ces révolutions, c'est que cette absolue
justice dans
la distribution des pouvoirs ne se rencontre pour
ainsi dire pas.
Quand une minorité est souveraine, la suprématie qu'elle exerce
repose presque toujours sur de tout autres
principes que cette proportionnalité idéale. Dans ces conditions,
la classe dirigeante a tout intérêt à éviter les nouveautés,
car elles éveilleraient les
prétentions, justes ou soi-disant telles, des classes dirigées, et
il y aurait à craindre alors non seulement un changement de
personnes, mais, et c'est ce qui importe à
l'objet de notre recherche, un
changement de constitution.
Déjà le seul fait que l'on a parfois changé violemment le
personnel
gouvernemental avec l'appui de la masse, suffit à
donner l'idée que le principe même
de l'aristocratie pourrait être renversé par la même
occasion.
Ainsi, la meilleure façon de se maintenir, pour une constitution
aristocratique, est de s'immobiliser le plus possible.
Cette
proposition ne s'applique pas seulement aux groupes politiques,
mais aux associations religieuses, aux sociétés familiales ou
mondaines qui peuvent prendre la forme aristocratique.
Partout où elle s'établit, ce n'est pas seulement pour le maintien
de certaines personnes au pouvoir, mais pour le maintien de son
principe même qu'un conservatisme rigide est nécessaire.
C'est
ce que montre clairement l'histoire des mouvements réformistes
dans les constitutions aristocratiques.
Quand ces sociétés
s'efforcent de s'adapter à des forces sociales nouvelles et à un
idéal nouveau, quand, par exemple, elles adoucissent l'exploitation
à laquelle étaient soumises les classes inférieures, en réglementant
les privilèges par la loi au lieu de les abandonner à
l'arbitraire, toutes ces réformes, dans la mesure où elles sont
volontairement concédées, ont pour but final, non les changements
mêmes qui en résultent, mais la stabilité qu'elles donnent aux
institutions qui sont conservées sans changement.
La diminution
des prérogatives aristocratiques n'est qu'un moyen
pour sauver le régime dans son
ensemble.
Mais une fois que les
choses en sont arrivées là, ces concessions sont, d'ordinaire,
insuffisantes.
Toute réforme met en lumière de nouveaux
points à réformer et le mouvement, auquel on avait accédé
pour maintenir l'ordre existant, mène, comme par une pente
douce, à la ruine de tout le système.
Dans ce cas, la seule chance
de salut est que, les prétentions nouvelles ne se laissant pas
réduire au silence, une réaction
radicale se produise et qu'on
revienne même sur les
changements antérieurement concédés.
Le bouleversement général auquel s'expose ainsi l'aristocratie,
quand elle se laisse modifier, explique qu'un immobilisme à
outrance soit pour elle le meilleur instrument de défense.
Lorsque la forme du groupe est caractérisée, non par la
suprématie d'une minorité, mais par l'autonomie de la majorité,
c'est encore une stabilité radicale qui en assure le mieux la
survie.
Cela tient d'abord à ce que les masses, quand elles
forment une unité sociale durable, ont un esprit essentiellement
conservateur.
Par là, elles s'opposent aux groupes temporaires
que forment les foules assemblées.
Celles-ci, au contraire,
montrent, dans leurs dispositions comme dans leurs décisions, la
plus grande mobilité; à la moindre impulsion, elles passent
d'un extrême à l'autre.
Mais quand la masse n'est pas sous le
coup d'une excitation immédiate,
quand une stimulation mutuelle de ses membres et une sorte de
suggestion réciproque ne
la met pas dans un état d'instabilité nerveuse qui rend impossible
toute direction ferme et la laisse à la merci de la première
impulsion, quand, en un mot, ses caractères profonds et durables
peuvent produire leurs effets, alors on la voit dominée
parla force d'inertie; elle ne
change pas d'elle-même son état de repos ou de mouvement,
mais seulement quand des forces
nouvelles entrent en ligne et l'y contraignent.
C'est pourquoi,
quand des mouvements sociaux sont l'œuvre des masses et leur sont
abandonnés sans direction, ils vont facilement jusqu'aux
extrêmes, tandis qu'inversement un équilibre social qui repose
sur les masses se rompt difficilement.
De là cet instinct salutaire
qui les pousse, pour garantir leur unité sociale contre la mobilité
des circonstances, à garder leurs formes telles quelles, dans
une immobilité opiniâtre, au lieu de les plier incessamment à tous
les changements du milieu.
Dans les sociétés politiques, une circonstance particulière
contribue à produire ce résultat: c'est que celles qui ont pour
base la classe la plus nombreuse
et où l'égalité des individus est
la plus complète, sont surtout
des sociétés agricoles.
C'est le cas
de la société de paysans que formait la Rome primitive et des
communes d'hommes libres qu'on rencontre dans l'ancienne Germanie.
Ici, la matière de la vie sociale détermine la manière dont la forme
se comporte.
L'agriculteur est un conservateur a priori. Son travail, pour
produire ses fruits, a besoin de temps et,
par conséquent, d'institutions durables et d'une stabilité parfaite.
L'impossibilité de prévoir ces caprices de la température
dont il est si étroitement dépendant, l'incline vers une sorte de
fatalisme qui se traduit par une résignation patiente vis-à-vis des
forces extérieures plutôt que par de la dextérité à éviter
leurs coups.
Sa technique, d'une manière générale, ne peut
répondre aux variations du milieu par des variations correspondantes
avec la promptitude dont sont capables l'industriel
et le commerçant; et ainsi, par suite des conditions mêmes de
l'art agricole, une organisation
sociale qui s'appuie sur une
vaste classe d'agriculteurs tend
naturellement à l'immobilité.
Mais il en est tout autrement quand la classe directrice est la
classe moyenne et que d'elle dépend la forme du groupe.
La raison en est dans une particularité qui lui est spéciale; seule,
elle a, à la fois, une limite
supérieure et inférieure.
Par suite, elle
reçoit sans cesse des éléments de la classe inférieure comme de la
classe supérieure et elle en donne à son tour et à l'une et à
l'autre.
Il en résulte qu'elle a pour caractéristique un état de
flottement qui fait que, pour se maintenir, elle a surtout besoin
d'une grande aptitude à s'adapter, à varier, à se plier aux
circonstances; car c'est à cette condition qu'elle peut diriger ou
prévenir les inévitables mouvements de l'ensemble, de manière
à garder intact, malgré les
changements qu'elle traverse, tout l'essentiel de ses formes
et de ses forces.
Une société de ce genre a pour caractère distinctif la continuité.
Elle n'implique, en effet, ni une égalité absolue entre les
individus, ni la division du groupe en deux parties radicalement
hétérogènes, l'une supérieure et l'autre inférieure.
La classe moyenne apporte avec elle un élément sociologique
entièrement nouveau.
Ce n'est pas seulement une troisième classe
ajoutée aux deux autres et qui
n'en diffère qu'en degrés, comme
elles diffèrent elles-mêmes l'une
de l'autre.
Ce qu'elle a de
vraiment original, c'est qu'elle fait de continuels échanges
avec les deux autres classes et que ces fluctuations perpétuelles
effacent les frontières et les remplacent par des transitions
parfaitement continues.
Car ce qui fait la vraie continuité de
la vie collective, ce n'est pas que les degrés de l'échelle sociale
soient peu distants les uns des autres — ce qui serait encore de la
discontinuité —; c'est que les individus puissent librement circuler
du haut en bas de cette échelle.
A cette seule condition, il
n'y aura pas de vides entre les classes.
Il faut que les carrières
individuelles puissent successivement passer par les plus hautes
et par les plus basses situations, pour que le sommet et la base de
la hiérarchie soient vraiment reliés l'un à l'autre.
Il est aisé de voir qu'il en est
de même à l'intérieur de la classe moyenne elle-
même; qu'il s'agisse de considération, d'éducation, de fortune,
de fonctions, les conditions n'y sont continues que dans la mesure
où une même personne peut en changer facilement.
Telles sont les raisons qui font qu'une société où la classe moyenne
est prédominante se caractérise par une grande élasticité;
c'est que, les éléments y étant très mobiles, il lui est plus
facile de se maintenir en variant si le milieu varie, qu'en restant
obstinément immuable.
Inversement, on pourrait montrer
qu'un groupe où les conditions sont nombreuses et rapprochées
les unes des autres doit rester plastique et variable, s'il ne
veut pas qu'il se produise
d'importantes ruptures dans sa masse.
Là où les situations possibles sont infiniment diverses,
les chances pour que chacun soit
à sa véritable place sont bien
moindres que dans une société où
il existe un système de classes
nettement définies et où, par suite, chaque individu est encadré
dans un groupe étendu et à
l'intérieur duquel il peut se mouvoir
avec une certaine liberté.
Dans ce dernier cas, en effet, comme la
société ne contient qu'un petit nombre de conditions tranchées,
chacun, au moins en règle générale, est naturellement dressé en
vue du cercle particulier dans lequel il doit entrer.
Car comme
ces cercles sont assez vastes et n'exigent de leurs membres que
des qualités assez générales, l'hérédité, l'éducation, l'exemple
suffisent à y adapter par avance les individus.
Il se produit ainsi une harmonie préétablie entre les qualités
individuelles et les conditions sociales.
Mais là au contraire où, grâce à l'existence
d'une classe moyenne, il y a toute une gamme de situations
variées et graduées, ces mêmes forces ne peuvent plus prédéterminer
les particuliers avec la même sûreté; l'harmonie qui,
tout à l'heure, était préétablie, doit, maintenant, être retrouvée
a posteriori
et par des moyens empiriques;
pour cela, il faut que
chaque individu puisse sortir de sa situation si elle ne lui
convient pas et que l'accès de celle à laquelle il est apte lui
soit ouvert.
Par conséquent, dans ce cas, ce qui est nécessaire au
maintien du groupe, c'est que les frontières des classes puissent
être aisément déplacées, constamment rectifiées, que les situations
n'aient rien de définitivement fixé.
C'est seulement de cette manière
que chacun pourra arriver à rencontrer la position spéciale qui
convient à ses qualités spéciales.
C'est pourquoi
une société où la classe moyenne domine doit employer, pour se
conserver, des procédés contraires à ceux qui servent à
une aristocratie.
VI
Dans ce qui précède, la variabilité des groupes a été étudiée
comme un moyen pour eux de s'adapter aux nécessités de la vie;
elle consiste à plier pour empêcher que tout ne se brise, et cette
souplesse s'impose toutes les fois que les formes sociales ne sont
pas assez fortement consolidées pour défier toutes les
forces destructives.
La société répond ainsi aux variations
qui se produisent dans les circonstances, tout en maintenant
son existence propre.
Mais on peut se demander maintenant si cette aptitude à passer par
des états variés, et même opposés, ne
sert à la conservation du groupe que comme un moyen de
réagir contre les changements du milieu, ou si elle n'est pas
également impliquée dans le principe même de sa constitution
interne.
En effet, abstraction faite de ce que peuvent être les circonstances
extérieures, la santé du corps social, considérée comme
le simple développement de ses énergies internes, ne réclame-t-
elle pas sans cesse des changements de conduite, des déplacements
d'intérêts, de continuelles variations de formes? Déjà les
individus ne peuvent se conserver qu'en changeant; ils ne
maintiennent pas l'unité de leur vie par un équilibre immobile
entre le dedans et le dehors, mais, pour des raisons d'ordre
interne, ils sont déterminés à
un mouvement perpétuel qui les fait passer incessamment non
pas seulement de l'action à la
passion et réciproquement, mais encore d'une forme de l'action
ou de la passion à une
autre.
De même, il n'est pas impossible que les forces d'où résulte la
cohésion de la société aient besoin de changement pour garder toute
leur action sur les consciences.
C'est ce qu'on peut notamment observer toutes les fois que
l'unité collective est devenue trop étroitement solidaire d'un
état social déterminé, ce qui arrive par cela seul que cet état dure
depuis très longtemps et sans changement.
Qu'un événement
extérieur vienne alors à l'ébranler, et l'unité sociale risque
d'être
emportée du même coup.
Par exemple, lorsque les sentiments
moraux ont été, pendant longtemps, intimement unis à certaines conceptions religieuses, le libre examen, en ruinant la
religion, menace la morale.
De même, l'unité d'une famille
riche se brise parfois, si cette famille s'appauvrit, comme,
d'ailleurs, l'unité d'une famille pauvre qui vient à s'enrichir.
De même encore, dans un État jusqu'alors libre, les pires
divisions éclatent si la liberté vient à se perdre (qu'on se
rappelle
Athènes à l'époque macédonienne); mais le même phénomène
se produit dans les États despotiques qui deviennent libres
brusquement, comme l'histoire des
révolutions l'a souvent
prouvé.
Il semble donc qu'une certaine variabilité empêche
le groupe de se solidariser trop complètement avec telle ou
telle particularité.
Les changements fréquents par lesquels il
passe, l'immunisent, pour ainsi
parler; beaucoup de ses parties
peuvent tomber, sans que le nerf
de la vie soit atteint, sans que le maintien du groupe soit
en péril.
Nous sommes, il est vrai, porté à croire que la paix, l'harmonie
des intérêts servent seuls dans ce but; toute opposition nous
paraît créer un danger et gaspiller stérilement des forces
qui pourraient être employées à
une œuvre positive de coordination
et d'organisation.
Et cependant, l'opinion contraire semble mieux fondée; les sociétés
ont intérêt à ce que la paix et
la guerre alternent d'après une sorte de rythme.
Cela est vrai
des guerres étrangères succédant à des périodes de paix internationale,
comme des guerres intestines, des conflits de partis,
des oppositions de toute sorte qui se font jour au sein même de
l'entente et de l'harmonie; toute la différence entre ces deux
ordres de faits, c'est que, dans
le premier cas, l'alternance est successive, dans le second,
simultanée.
Mais le but poursuivi est le même; seuls, les moyens par lesquels il
se réalise sont différents.
La lutte contre une puissance étrangère donne au groupe
un vif sentiment de son unité et de l'urgence qu'il y a à la
défendre envers et contre tout.
La commune opposition contre
un tiers agit comme principe d'union, et cela beaucoup plus
sûrement que la commune alliance avec un tiers; c'est un fait
qui se vérifie presque sans exception.
Il n'est, pour ainsi dire, pas de groupe, domestique, religieux,
économique, politique, qui puisse
se passer complètement de ce ciment.
La conscience
plus nette qu'une société prend de son unité, par l'effet de la
lutte, renforce cette unité, et réciproquement.
On dirait que, pour nous autres hommes, dont la faculté essentielle
est de percevoir des différences,
le sentiment de ce qui est un et
harmonique ne puisse prendre de
forces que par contraste
avec le sentiment contraire.
Mais les antagonismes qui séparent les éléments mêmes du groupe
peuvent avoir les mêmes effets;
ils donnent plus de relief à son unité, parce que, en tendant, en
resserrant les liens sociaux, ils les rendent plus sensibles.
Il est
vrai que c'est aussi un moyen de les briser; mais tant que cette
limite extrême n'est pas atteinte, ces conflits, qui, d'ailleurs,
supposent un premier fonds de solidarité, la rendent plus
agissante, que les sujets en aient ou non conscience.
Ainsi,
les attaques auxquelles les différentes parties d'une société se
livrent les unes contre les autres ont souvent pour conséquence
des mesures législatives qui sont destinées à y mettre un terme
et qui, tout en ayant pour
origine l'égoïsme et la guerre,
donnent à la communauté un
sentiment plus vif de son unité et de sa solidarité.
Ainsi encore, la concurrence économique,
par les actions et les réactions
qu'elle détermine, met plus
étroitement en rapports les
clients et les marchands même
qui se font concurrence, et elle
accroît leur dépendance réciproque.
Enfin et surtout, le désir de prévenir les oppositions et
d'en adoucir les conséquences conduit à des ententes, à des
conventions commerciales ou autres qui, quoique nées d'antagonismes
actuels ou latents, contribuent d'une manière positive
à la cohésion du tout.
Cette double fonction de l'opposition, selon qu'elle est
tournée vers le dehors ou vers le dedans, se retrouve dans les
relations les plus intimes des particuliers et elle y a tous les
caractères d'un phénomène
sociologique; car les individus eux
aussi ont besoin de s'opposer
pour rester unis.
Cette opposition
peut se
manifester également, ou bien par le contraste que présentent les
phases successives de leur commerce, ou bien
par la manière dont le tout
qu'ils forment se différencie du
milieu moral qui les enveloppe.
On a souvent dit que l'amitié et
l'amour ont besoin parfois de différends, parce que la réconciliation
leur donne tout leur sens et toute leur force.
Mais ces
mêmes associations, sans présenter de ces différences externes,
peuvent devenir plus conscientes de leur bonheur, en s'opposant
au reste du monde, à tout ce qui s'y passe et à tout ce qu'on
en sait.
Cette seconde forme d'opposition est certainement la
plus haute et la plus efficace.
La première a d'autant moins de
valeur que les périodes alternées d'accord et de conflit sont plus
courtes et se suivent de plus près.
A son degré le plus bas, elle
est caractéristique d'un état où la nature des relations internes
entre
les individus n'a, pour ainsi dire, plus d'importance, où leurs
dispositions respectives sont à la merci des accidents
extérieurs, qui tantôt les rapprochent et tantôt les tournent
les uns contre les autres.
Et cependant, même alors, elle a
quelque chose de profondément utile à la conservation du
lien social.
Car là où les parties sont rarement incitées à prendre
conscience de leur solidarité et où, par suite, elles n'en ont
qu'un faible sentiment, rien ne peut être plus propre à l'éveiller
que ces chocs et ces conflits perpétuels, suivis de perpétuelles
réconciliations.
C'est de la lutte même que naît l'unité.
Nous revenons
ainsi au point de départ de ces considérations.
Le fait que l'opposition peut servir à la conservation du
groupe est
l'exemple le plus topique de l'utilité que présente,
dans ce même but, la variabilité
sociale en général.
Car s'il est
vrai que l'antagonisme ne meurt jamais complètement, il est
cependant dans sa nature de n'être jamais qu'un intervalle entre
deux périodes d'accord.
Par définition, ce n'est qu'une crise,
après laquelle l'union sociale se reconstitue par suite des nécessités
même de la vie; et il en est ainsi sans doute, parce que, ici
comme
partout, ce qui dure n'a de relief et ne prend toute sa
force au regard de la conscience
que par contraste avec ce qui
change.
L'unité sociale est l'élément constant qui persiste identique
à soi-même, alors que les formes particulières qu'elle
reçoit et les
rapports qu'elle soutient avec les intérêts sociaux
sont infiniment mobiles; et
cette constance est d'autant plus accusée que cette mobilité
est plus grande.
Par exemple,
la solidité d'une union conjugale varie certainement, ceteris
paribus, suivant la diversité plus ou moins grande des
situations par lesquelles ont
passé les époux; car ces changements mettent en saillie
l'inaltérabilité de leur union.
Il est dans la nature des choses humaines que les contraires se
conditionnent mutuellement.
Si la variabilité importe tellement à la conservation du
groupe, ce n'est pas seulement parce que, à chaque phase
déterminée, l'unité s'oppose à ces variations passagères, mais
parce
que, dans toute la suite de ces transformations, qui ne sont jamais
les mêmes d'une fois à l'autre, elle seule se répète
sans changement.
Elle acquiert ainsi, vis-à-vis de ces états
discontinus, ce caractère de fixité et cette réalité que la vérité
possède par opposition à l'erreur.
La vérité n'a pas, dans chaque
cas particulier, une sorte de privilège, un avantage mystique sur
l'erreur; et cependant elle a plus de chances de triompher, pour
cette raison qu'elle est une tandis que les erreurs possibles à
propos
d'un même objet sont en nombre infini.
Elle revient
donc plus souvent dans le cours
des pensées, non que l'erreur en
général, mais que telle erreur en
particulier.
C'est ainsi que
l'unité sociale a des chances de se maintenir et de se renforcer à
travers
toutes les variations, parce que celles-ci diffèrent toujours
l'une de l'autre, tandis qu'elle reparaît toujours identique.
Par suite de cette disposition des choses, les avantages de la
variabilité, qui ont été énumérés plus haut, peuvent être conservés,
sans que les variations qui se produisent entament
sérieusement
le principe même de l'unité.
Nous terminons ici cette étude qui, de parla nature même du
sujet, ne vise nullement à être complète, mais a plutôt pour but
de
donner un exemple de la méthode qui seule, d'après nous,
peut
faire de la sociologie une science indépendante, et qui
consiste à abstraire la forme de
l'association des états concrets, des intérêts, des
sentiments qui en sont le contenu.
Ni la faim,
ni l'amour, ni le travail, ni la
religiosité, ni la technique, ni les
produits intellectuels ne sont
par eux-mêmes de nature sociale;
mais c'est le fait même de
l'association qui donne à toutes ces choses leur réalité.
Quoique la
réciprocité d'action, l'union, l'opposition des hommes n'apparaisse
jamais que comme la forme de
quelque contenu concret, ce n'est cependant qu'en isolant
cette forme par l'abstraction, qu'on pourra constituer
une science de la société, au
sens étroit du mot.
Que le contenu
réagisse toujours sur le contenant, cela ne change rien à la
question.
L'étude géométrique des formes des cristaux est un
problème dont la spécificité n'est nullement diminuée par ce
fait que la manière dont ces formes se réalisent dans les corps
particuliers varie suivant la constitution chimique de ces derniers.
La quantité de problèmes que ce point de vue permet de
dégager paraît hors de doute.
Seulement, étant donné que,
jusqu'à présent, on n'a pas encore su le faire servir à déterminer
un champ d'études qui soit spécial à la sociologie, il importe
avant
tout d'habituer les esprits à discerner, dans les phénomènes particuliers, ce qui est proprement sociologique et ce qui
ressortit à d'autres disciplines; c'est la seule manière d'empêcher notre science de glaner perpétuellement dans le champ des
voisins.
C'est à ce but propédeutique que répond la présente
recherche.
|